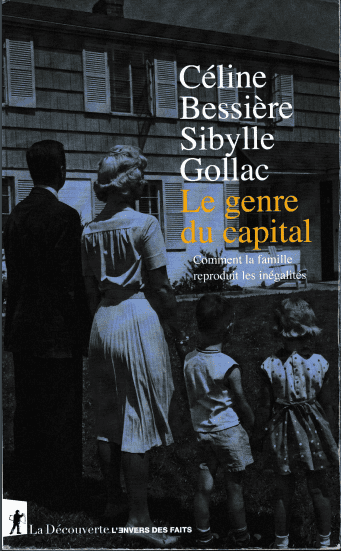Dans cette deuxième partie sur l’ouvrage « Le Genre du Capital », plongeons au sein des familles et de leur stratégie familiale de reproduction sociale, aux bénéfices des héritiers masculins et ex-conjoints.
Une nécessaire sociologie féministe matérialiste de la famille comme
institution économique
Le préalable évident à toute analyse des mécanismes familiaux de reproduction des inégalités économiques de genre est de considérer la famille comme une institution économique. A rebours d’un « grand récit de la famille moderne occidentale » qui considère que cette dernière « ne serait plus fondée sur l’interdépendance économique de ses membres ni centrée sur les enjeux de transmission économique d’une génération à la suivante », Céline Bessière et Sibylle Gollac s’appuient sur les travaux récents renouvelant l’analyse des classes sociales et des inégalités pour considérer que « la famille constitue […] une instance primordiale de production, de circulation, de contrôle et d’évaluation de la richesse ».
Sans nier l’apport essentiel de la sociologie critique et de sa conceptualisation du rôle du capital culturel dans la reproduction des hiérarchies sociales, les autrices considèrent toutefois que « paradoxalement, l’analyse bourdieusienne de la reproduction a aussi contribué à détourner l’attention des sciences sociales pour les transmissions économiques familiales ». Or, dans un contexte où l’accès à l’éducation, à l’emploi et au logement est surdéterminé par l’existence d’un patrimoine et d’appuis économiques familiaux , ces transmissions ne peuvent être délaissées par les sociologues.
Les effets d’un tel contexte sont loin d’être neutres : « Ce retour de l’héritage est aussi un retour de l’institution familiale comme acteur clé de l’économie, qui contribue à produire des inégalités socio-économiques fortes et à renforcer les frontières de classes, mais aussi de races ». En témoignent les travaux de Margot Delon qui souligne l’importance du patrimoine immobilier des familles d’origine portugaise dans la construction de leur blanchité et leur démarcation vis-à-vis des minorités coloniales et post-coloniales.
Le renforcement des frontières sociales de classes et de ‘races’ concerne aussi celles de genre. Comme l’ont souligné les féministes matérialistes (pour plus d’informations sur le féminisme matérialiste) – notamment Christine Delphy, citée par les autrices – la famille patriarcale est le lieu d’un travail gratuit et invisibilisé : le travail reproductif et domestique, accompli essentiellement par des femmes au détriment de leur carrière professionnelle. Cette spécialisation des femmes dans la production domestique produit en retour d’importants effets sur leur aptitude à accumuler du capital.
Ainsi l’enquête proposée par les autrices ne peut-elle prendre place que dans le cadre d’une « sociologie matérialiste de l’institution familiale ». Il convient cependant de ne pas tordre le bâton à l’excès, en considérant la famille comme une institution purement économique et nécessairement nucléaire. Si la famille est bel et bien une institution économique, la production et la répartition des richesses y est intrinsèquement liée à des échanges affectifs, comme l’explique Viviana Zelizer : « […] Malgré leur caractère ordinaire, ces transactions intimes [au sens de Viviana Zelizer] suscitent le malaise : elles constituent toujours un mélange des genres entre famille et argent qui peut susciter malentendus et conflits. Afin de les éviter, les personnes apparentées dépensent une énergie sociale considérable – ce que Viviana Zelizer nomme le travail relationnel (relational work) – à préciser les droits, les obligations et les significations sociales de leurs pratiques . »
Ces quelques clarifications méthodologiques établies, il devient possible de s’interroger sur la problématique centrale de l’enquête : « Comment les arrangements économiques familiaux […] participent-ils au maintien des frontières entre les classes sociales et, dans le même temps, au creusement des inégalités économiques entre les hommes et les femmes ? »
Organiser la reproduction familiale par la transmission différenciée
(et inégalitaire) du patrimoine
Si les arrangements économiques familiaux structurent le fonctionnement ordinaire et quotidien des familles, ils sont mis en lumière, définis et redéfinis dans certains moments-clefs, notamment lors de l’organisation des successions – qui, selon les milieux sociaux, peut prendre place dès la naissance d’un héritier potentiel…
Si le droit successoral français est théoriquement égalitaire depuis 1804, il ne permet aux femmes de disposer pleinement des biens hériter que depuis 1965 – le mari ayant jusqu’alors l’autorité sur la gestion des biens et des décisions patrimoniales. Par ailleurs, les aménagements progressifs à la répartition des héritages, initialement indivis ou en lots équivalents en valeur et en nature, ont permis de multiples accommodements pour les stratégies familiales de reproduction.
Quand bien même leur valeur monétaire serait équivalente – alors qu’elle est loin de l’être en réalité – tous les héritages ne se valent pas. Les autrices distinguent, à la suite de nombreux travaux anthropologiques, les biens structurants d’un héritage, les « choses qu’il faut garder » car elles constituent des biens symboliquement attachés à l’identité familiale (entreprise, maison ou terrain « de famille ») d’autres biens à la fonction surtout économique (actifs, logements mis en location, etc) ou des transferts monétaires compensatoires en cas d’héritage déséquilibré. Ces biens structurants sont alors transmis prioritairement à un « bon héritier », dont la conception est « genrée et socialement située », supposé apte à conserver et accroître le patrimoine familial. Ce « bon héritier » est majoritairement le fils aîné, selon des schémas de primogéniture agnatique rapprochés par une enquête à la loi salique : si les familles d’indépendants (artisans, commerçants, paysans, chefs d’entreprise) apparaissent comme les archétypes de ces successions, Céline Bessière et Sibylle Gollac soulignent à quel point les familles de salariés restent influencées par de telles tendances, notamment du fait de l’apparentement très fréquent à des indépendants (la société salariale restant, à l’échelle d’une histoire familiale, relativement récente).
L’héritier présumé est socialisé – plus ou moins consciemment et explicitement – à son rôle par différents membres de sa famille, parfois à un âge précoce, tel cet arrière-petit-fils que l’on familiarise au monde agricole, entre autres par des jouets d’engins agricoles. La transmission, dans les familles aux ressources économiques, informationnelles et culturelles suffisantes pour permettre des stratégies de reproduction élaborées, s’organise selon un rythme propre au « bon héritier » : « […] le tempo de ces donations dépend de la temporalité de l’entreprise familiale. Les frères et soeurs du repreneur reçoivent d’éventuelles soultes [compensations] au rythme de la vie de l’exploitation et de sa transmission, et non en fonction de leur propre rythme d’accumulation (acquisition d’une résidence principale, paiement des études des enfants, etc.) »
Enfin, puisque les « bons héritiers » sont tendanciellement des fils aînés, que les filles sont moins intégrées aux stratégies de reproduction familiale, qu’elles tendent à s’orienter vers des secteurs moins rémunérateurs, et que les écarts d’âge dans les couples sont marqués par des hommes plus vieux, et donc plus avancés dans leurs carrières professionnelles et dans l’accumulation de patrimoine, les stratégies conjugales vont favoriser l’homme comme étant le conjoint le plus avancé.
La figure du « bon héritier », un homme jeune et compétent, trouve son envers dans celle de la veuve, une femme âgée, ‘pièce rapportée’ dans la lignée, suspectée inapte à conserver le patrimoine familial. Les veuves ont ainsi été historiquement discriminées dans le droit successoral, reléguées dans l’ordre successoral après les frères et sœurs (« collatéraux privilégiés ») jusqu’en 2001. En raison des écarts d’âge et d’espérance de vie, les femmes font bien plus fréquemment l’expérience d’une fin de vie en maison de retraite, sans jouissance du patrimoine familial.
L’ambiguïté des mariages à l’heure des séparations
La place ambiguë des veuves dans les stratégies familiales de reproduction conduit à s’interroger sur l’autre processus central de la reproduction familiale : les stratégies matrimoniales.
Comme cela a été évoqué, les couples se structurent tendanciellement autour des carrières professionnelles et des opportunités patrimoniales masculines ; par ailleurs, dans le cas où la femme dispose d’un patrimoine supérieur à celui de son conjoint, sa situation professionnelle souvent moins avantageuse et sa position dominée dans l’héritage tendent à renverser l’avantage initial (un patrimoine supérieur) au bénéfice de l’homme.
Le régime légal des mariages est par défaut celui de la « communauté de biens réduite aux acquêts », qui implique une propriété commune du patrimoine des conjoints, à l’exclusion des biens possédés antérieurement au mariage et des héritages. Toutefois, ici comme ailleurs, derrière un droit d’apparence égalitaire se dissimulent des mécanismes sociaux défavorables aux femmes : le patrimoine antérieur au mariage et l’héritage étant tendanciellement plus élevé chez les hommes, et cette ‘avance’ légitimant des stratégies conjugales centrées sur la carrière et le patrimoine masculins, l’homme pouvant faire fructifier son patrimoine antérieur.
Les séparations sont à cet égard un révélateur et un amplificateur des inégalités patrimoniales au sein du couple : la liquidation de la communauté matrimoniale révèle la propriété réelle du patrimoine, cependant que les femmes sortent plus appauvries que les hommes des séparations, du fait de carrières malmenées par le travail domestique et reproductif insuffisamment reconnu et partagé, de la responsabilité parentale plus fréquente à laquelle elles sont astreintes, laquelle n’est que partiellement amortie par les pensions alimentaires et prestations compensatoires.
Si la communauté de biens n’est pas neutre sur l’accumulation différenciée de capital, la « séparation de biens », un régime dérogatoire du contrat de mariage, est clairement défavorable aux femmes. Une tendance récente à l’individualisation des patrimoines, non sans lien avec la forte hausse des divorces et séparations depuis les années 1980, a conduit à un recours bien plus fréquent aux mariages en séparation de biens, chaque conjoint-e étant alors libre de faire fructifier son patrimoine de son côté – les hommes étant évidemment bien plus fréquemment avantagés par ce type d’union : « Dans un contexte de généralisation des séparations conjugales, l’individualisation des patrimoines correspond ainsi à une forme de protection des mécanismes d’accumulation et de transmission de la richesse familiale en lignée masculine. »
Enfin, les couples non mariés – plus d’un quart selon l’INSEE en 2015 – ne sont pas tenus aux mêmes contraintes légales sur la communauté matrimoniale, et « la question de l’alignement des droits des couples non mariés sur les couples mariés en matière de séparation conjugale» n’est pas un sujet d’actualité en France, contrairement au Canada ou à l’Angleterre.
Ainsi, il apparaît clairement que les stratégies familiales de reproduction et les arrangements économiques familiaux sont tendanciellement défavorables aux femmes. Pis, les inégalités de genre faisant système, un potentiel avantage patrimonial de la femme peut se trouver contrebalancé par d’autres facteurs discriminants (positionnement dans la fratrie par rapport à l’héritage, carrière professionnelle, âge…) rétablissant une domination masculine. Les stratégies familiales d’accumulation et de transmission ne prennent pas place hors du monde social, mais se construisent avec la collaboration de – et plus rarement en opposition à – diverses professions juridiques, dans un mouvement de va-et-vient entre les arrangements interpersonnels et leur traduction légale.
Cette série d’articles est le fruit d’un travail réalisé en collaboration avec Louis B-F.