Série sur l’indépendance du juge (1/3) : Le 26 octobre dernier, Donald Trump présentait Amy Coney Barrett au balcon de la Maison blanche, après sa nomination en qualité de juge à la Cour suprême des États-Unis. De nombreux articles sont parus pour questionner la politisation de la juridiction suprême outre-atlantique, mettant en exergue les liens étroits que l’institution noue depuis sa création avec le pouvoir fédéral. Il serait impossible, en France, de voir les magistrats de la Cour de cassation être nommés de manière aussi ouvertement politisée. Au contraire, on s’attache à la plus grande impartialité de nos juges.
I. Les fondements philosophiques de l’indépendance du juge
L’indépendance du juge est une notion centrale du droit, garantie fondamentale des libertés et de la régularité d’une décision juridique. C’est pourquoi elle est affirmée aujourd’hui dans de nombreux textes, comme nous le verrons plus tard. Néanmoins, cette exigence d’indépendance n’est pas le fruit exclusif des textes normatifs. Au contraire, elle s’inscrit dans une réflexion philosophique, et a fortiori celle des Lumières, qui a érigé les droits fondamentaux en principe inaliénable, dont celui d’une justice équitable. Ainsi, Montesquieu théorise dès 1748 dans son ouvrage De l’esprit des lois la séparation des pouvoirs – ou plutôt la séparation des puissances comme il l’écrit – pour atteindre une forme de gouvernement qui soit dans l’intérêt de tous, et qui puisse garantir les principes rappelés plus hauts. Le cœur de cette argumentation repose sur le triptyque fondamental exécutif – législatif – judiciaire :
Tout serait perdu si le même homme, ou le même corps exerçait ces trois pouvoirs : celui de faire les lois, celui d’exécuter les résolutions publiques, et celui de juger les crimes ou les différends des particuliers.
Il apparaît dès lors que le juge ne peut pas interférer dans la rédaction de la Loi, ni dans son exécution. Il n’a pour mission que d’appliquer la loi aux litiges qui lui sont soumis. Toutefois, cette limitation du pouvoir du juge est une garantie pour son indépendance, parce qu’elle implique que les deux autres pouvoirs, à savoir exécutif et législatif, ne peuvent pas interférer dans l’exercice de la justice, qui est du seul ressort des magistrats. Ces derniers doivent être séparés par nature des autres pouvoirs, d’où le terme d’indépendance. Cela étant dit, il faut à présent étudier l’application de ce principe philosophique dans les textes, et dans les faits.
II. L’indépendance affirmée du juge judiciaire
A. La relative absence d’autonomie du juge sous l’Ancien Régime
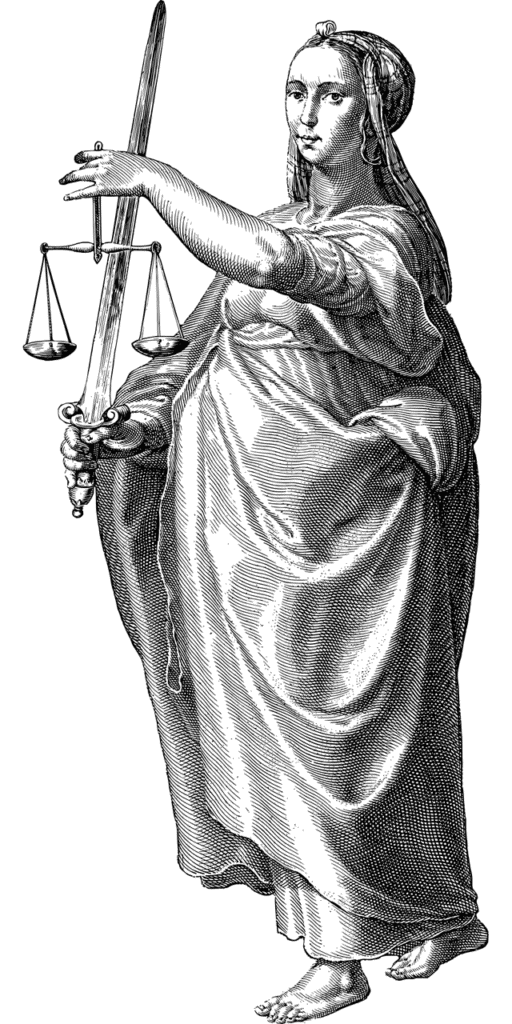
Sous l’époque féodale, les seigneurs et le clergé ont le monopole de l’exercice de la justice. En cela, ils sont totalement indépendants et souverains dans leurs décisions. Toutefois, ils sont en réalité liés aux parties au litige, puisqu’ils sont payés par les plaideurs. Ainsi, le juge rendait une justice partiale, et très souvent au bénéfice de la partie la plus généreuse. Néanmoins, sous la monarchie, la justice n’est plus rendue au nom des seigneurs et du clergé, mais au nom du Roi, qui est investi, lors de son sacre, du pouvoir temporel de la justice, symbolisé par la main de justice.
Jusqu’au XIIIème siècle, le système juridique est marqué par la justice retenue, c’est-à-dire rendue par le roi lui-même, ou par des instances nommées auprès de lui. Puis la justice devient déléguée, c’est-à-dire que le souverain délègue à des juges spécialement nommés le droit de rendre la justice au nom du roi, tout en conservant un droit de regard sur les affaires, voire un droit de les juger lui-même. Cette délégation de la justice s’exprime visuellement par l’habit du magistrat : robe pourpre et herminée qui rappelle celle du sacre du roi et un couvre-chef (le mortier) rappelant la couronne. Peu à peu, le juge devient donc plus ou moins autonome, quand bien même il demeure soumis à l’autorité royale. Ainsi, lorsqu’en 1766 le Parlement de Rennes (équivalent de nos cours d’appel actuelles) démissionne suite à un conflit avec le pouvoir central, celui de Paris le soutient et se dresse contre le roi. Louis XV prononce alors un discours devant le Parlement, qui rappelle la souveraineté du roi sur les juges :
Comme s’il était permis d’oublier que c’est en ma personne seule que réside la puissance souveraine dont le caractère propre est l’esprit de conseil, de justice et de raison. Que c’est de moi seul que les Cours tiennent leur existence et leur autorité. Que la plénitude de cette autorité qu’elles n’exercent qu’en mon nom, demeure toujours en moi et que l’usage n’en peut jamais être tourné contre moi
Pour mettre fin au pouvoir royal, il a donc été normal que le pouvoir révolutionnaire ait voulu affirmer l’indépendance du pouvoir judiciaire.
B. L’affirmation de son indépendance sous la Révolution
Notre justice actuelle est, dans les grandes lignes, calquée sur celle établie sous la Révolution. L’œuvre révolutionnaire a profondément modifié la justice, à la fois dans son organisation, mais aussi dans le statut des magistrats.
1. L’indépendance du juge vis-à-vis des plaideurs
Le premier apport des révolutionnaires en matière d’indépendance des juges est de ne plus les lier aux plaideurs. En effet, nous l’avons vu, les magistrats étaient payés par les parties au litige sous l’Ancien Régime, ce qui rendait partiales leurs décisions. Avec les lois des 16 et 24 août 1790, le législateur avait entendu mettre fin à ce système en rendant la justice gratuite (principe fondé sur l’impératif d’égalité des justiciables devant les juridictions). Ainsi, les justiciables n’ont plus à payer pour avoir accès à la justice. Le juge n’étant plus lié financièrement aux parties, il acquiert donc une autonomie dans sa prise de décision. Parallèlement, le juge devient aussi indépendant dans son statut.
2. L’indépendance dans les statuts des magistrats
L’époque révolutionnaire met fin à la noblesse de robe, qui prévalait sous l’Ancien Régime. Alors que les magistrats étaient auparavant des notables, les décrets du 4 août 1789 mettent fin à la justice seigneuriale, qui existait en parallèle de la justice royale pour les litiges concernant la vie quotidienne. Ainsi, les seigneurs n’ont plus le privilège de justice sur leurs terres. Les magistrats n’ont plus besoin de justifier d’une ascendance noble ou de l’achat d’une charge. Par ailleurs, les juges sont élus par les citoyens. Ils sont donc investis de la souveraineté du peuple et rendent la justice en son nom (d’où l’en-tête des jugements : « Au nom du peuple français »). Tout le monde peut donc devenir juge et ils sont indépendants de tout pouvoir hiérarchique, puisqu’ils n’ont pas besoin de rendre de comptes à un supérieur qui les a nommés. La Révolution a donc posé les bases de la justice actuelle, et notamment le principe de juges autonomes et indépendants. Toutefois, ces avancées considérables seront mises à mal par l’époque napoléonienne, soumettant le juge au pouvoir politique (voir l’affaire d’Enghien). Il faudra donc attendre le droit moderne, et notamment la Constitution de 1958 pour arriver à une véritable indépendance des magistrats, comme il sera vu dans un prochain article.
Sources :
Lacene, C. (2007, 7 février) La justice sous la monarchie. Ministère de la justice. http://www.justice.gouv.fr/histoire-et-patrimoine-10050/la-justice-dans-lhistoire-10288/la-justice-sous-la-monarchie-11910.html
Bertozzo, M. (2015). Le 3 novembre 1790, la mise au pas des juges sous la Révolution, De la vacance indéterminée à l’abolition des Parlements d’Ancien Régime. Revue générale du droit on line, 2015, numéro 22827 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=22827)
Cour de cassation, La réalité de l’indépendance judiciaire. https://www.courdecassation.fr/IMG/File/pdf_2007/10-05-2007/10-05-2007_girardet.pdf
Duquesne, Q. (2010). Du juge seigneurial au juge de paix. Les détenteurs des fonctions judiciaires de proximité de la fin de l’Ancien Régime au Consulat : le cas de l’Isère. Histoire, économie & société, 29e année(2), 45-64. https://doi.org/10.3917/hes.102.0045
