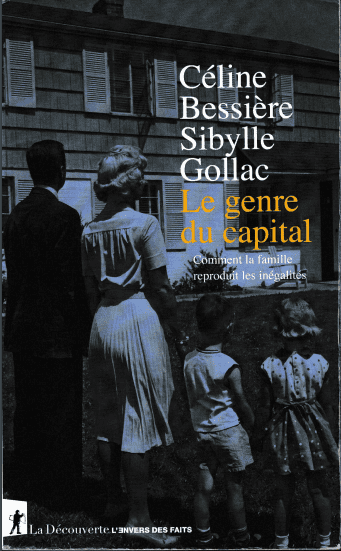Dans cette troisième partie sur l’ouvrage « Le Genre du Capital », attardons-nous sur les professions juridiques, notaires, avocats et juges, qui accompagnent et parfois mettent en places les stratégies des familles aux impensés sexistes.
Une socialisation genrée au droit et à ses professionnel-le-s
Le rapport au droit des individus est très différent en fonction du genre, de la classe ou de la race. De facto, le coût des services ou des conseils des professionnels du droit est élevé, et l’aide juridictionnelle ne permet pas de couvrir toutes les situations de précarité. Mais c’est le principe même du recours à des professionnel-les, ou la connaissance des normes en droit de la famille, qui fait défaut aux dominé-es, classes populaires ou femmes. De manière générale, ces deux catégories sociales ont moins d’occasion de fréquenter de tels acteurs : les classes populaires car elle ne possèdent pas de patrimoine ou pas un patrimoine qui le nécessite, et les femmes puisqu’elles sont souvent écartées de la gestion du patrimoine, ou parce qu’elles en possèdent moins que les hommes. Ainsi, les arrangements en-dehors du droit des femmes sont plus précaires car ils n’ont pas fait l’objet d’un accompagnement par des professionnel-les, et peuvent plus facilement être remis en cause (exemple d’une mère qui va révéler l’argent transmis par sa mère en liquide non déclaré). On constate donc qu’être une femme et être issue des classes populaires crée une double problématique dans l’accès au droit et à ses professionnel-les. Les notaires et avocats, en-dehors des actes tarifés, peuvent fixer un prix libre pour leurs conseils, qui leur sont souvent inaccessibles.
Outre l’accès aux professionnels du droit, qui permet d’établir une stratégie conforme à la loi, les classes supérieures et les hommes bénéficient d’une socialisation plus marquée au droit en raison des différents contacts qu’ils établissent. La présence dans le patrimoine de biens immobiliers est ici un facteur déterminant. Ainsi, ce sont ces mêmes catégories qui bénéficient d’un plus gros investissement des professionnel-les, d’un service adapté et sur mesure. Les possédant-es, dès lors, ont la prévision et la discrétion, leur permettant de s’arranger avec le droit. A l’opposée, les non-possédant-es, notamment parmi les femmes et classes populaires, ont un risque accru d’être sanctionné par l’administration judiciaire en cas d’illégalité.
Les notaires, en charge de collecter l’impôt, ou les autres professionnel-les du droit en charge de la gestion du patrimoine, ont pour habitude, afin de fidéliser la clientèle, de se présenter comme « médecin du patrimoine », « garant de la paix des familles » ou pour les avocat-es d’expert en « droit négocié » (procédure extra-judiciaire de résolution à l’amiable des divorces). Leur objectif est de permettre à leurs client-es des « arrangements patrimoniaux », théoriquement non-conformes aux normes mais qui, à l’ombre du droit, le deviennent, au sein des études notariales ou des cabinets d’avocat-es. La mise en place d’une stratégie familiale permet dans la plupart des cas d’éviter l’institution judiciaire.
Dans les situations de conflit, les individus aux ressources économiques les plus faibles se voient contraint-es d’avoir recours à des professionnel-les inexpérimenté-es ou non-spécialistes, notamment grâce à l’aide juridictionnelle, causant un déséquilibre face aux professionnel-les expérimenté-es et spécialisé-es membres de grands cabinets. Ces derniers auront dès lors la possibilité d’avoir recours à plus d’instruments complexes, comme peut l’être le droit de la famille international, champ qui est très peu mobilisée par les avocat-es de l’aide juridictionnelle, économisant temps et argent, au détriment des client-es. Les autrices pointent que « Ces inégalités de traitement ont aussi un genre, puisque du fait des inégalités de revenus entre les hommes et les femmes ces dernières ont davantage recours à l’aide juridictionnelle : c’est le cas d’un tiers d’entre elles, contre seulement un sixième des hommes ». Ainsi, de manière transversale aux classes sociales, les femmes ont de plus grandes difficultés à défendre leurs intérêts.
Le recours moindre des femmes aux professionnel-les du droit a pu être expliqué en raison de leur exclusion de la gestion du patrimoine familial. La sociologue Camille Herlin-Giret qualifie de « propriété sans appropriation » ce rapport des femmes au patrimoine. Cela mène à une méconnaissance de la situation économique du couple et d’une dépendance au mari pour la gestion des tâches administratives (impôts…). Dans le cas des familles plus riches, ce n’est plus l’homme qui gère directement le patrimoine, mais des professionnel-les. Il reste cependant l’interlocuteur et le principal décisionnaire. Ces professionnel-les ont tout intérêt à préserver ou faire fructifier le capital, il est la base de leur rémunération. Ainsi, le protéger de l’administration fiscale est un enjeu, qui est résolu par la complexification de la gestion du patrimoine (montages financiers…). Cela se fait au détriment de la femme, exclue dès le départ de cette gestion. Il est à noter que ce rapport à l’impôt n’est pas le même pour la partie dominée de la classe dominante, les professionnel-les préférant mettre en garde les client-es et instaurant de la méfiance. Pour les classes populaires, Florence Weber identifie comme moyen de contournement de l’impôt le recours au « travail au noir », au-delà des professionnel-les du droit.
L’optimisation fiscale est un enjeu majeur à l’occasion des divorces et des successions. Il est en quelque sorte le ciment de la paix des familles, et amène souvent certains individus, de manière générale les femmes, à accepter d’être lésé-es. L’argent revient donc soit à l’administration fiscale, soit aux hommes.
Les stratégies, que ce soit à l’occasion de divorces, de donations ou de successions, sont fortement influencées par les professionnel-les du droit. Il y a dès lors un constat qui a son importance : l’homologie entre ces professionnels et leurs clients masculins, au détriment évident des classes populaires et des femmes. La sociologie de la professions montre que les notaires sont des possédants qui partagent un intérêt commun pour la préservation de la richesse dans le temps et sa transmission familiale, tout en ayant une vision masculine de cette transmission, avec la vision du « bon héritier ». Il est donc logique que ces professionnel-les conseillent en ce sens leurs clients, puisque cela fait appel à leur propre expérience. Les notaires sont issu-es de classes socioprofessionnelles supérieures et sont majoritairement des hommes. A titre d’information, une charge vaut entre 400000 et 1000000 d’euros, et le salaire moyen des notaires titulaire d’une charge est de 17000 euros, soit plus que le salaire du Président de la République française. La profession se féminise, mais lentement. La récente création de charges qui ont bénéficié aux femmes s’est suivi d’un rapport de l’Autorité de la Concurrence, à la conclusion : « Alors que beaucoup de contributeurs indiquaient que la forte proportion de femmes dans des fonctions de notaire salarié relevait d’un choix personnel et que ces dernières ne souhaitaient pas accéder aux responsabilités impliquées par l’exercice libéral, le nombre de femmes notaires nommées aux offices créés, qui – compte tenu des modalités de tirage au sort – doit être à peu près équivalent au pourcentage de candidates, indique au contraire une appétence certaine de ces dernières pour l’entreprenariat. »
Cette connivence entre clients masculins et fortunés et professionnel-les du droit conduit ceux-ci à établir des stratégies défavorables aux femmes, comme la séparation des biens, instrument de maintien de patrimoines familiaux. Ce contrat de mariage est dès lors bien loin d’être neutre en ce qui concerne l’égalité femme-homme. Les autrices pointent ainsi que « les stratégies de reproduction de cette profession à patrimoine qu’est le notariat s’appuient donc sur les mêmes mécanismes sexistes que celles de leur clientèle possédante, et se traduisent par une discrimination des femmes ».
Des calculs patrimoniaux effectués selon des comptabilités inversées aux effets sexistes
Que ce soit à l’occasion d’un divorce ou d’une succession, les professionnel-les du droit usent de la « comptabilité inversée » pour déterminer la répartition du patrimoine. Procédé contraire à la lettre de la loi, il permet de s’arranger avec celle-ci.
Lors d’une répartition successorale, la norme est la suivante : il faut inventorier les biens, les évaluer et ensuite les répartir pour que chaque successeurs ait une part équivalente, compensable avec la soulte. Or, ce que font dans la plupart des cas les notaires, c’est l’inverse : ils répartissent les biens puis les évaluent de manière à ce que le tout se retrouve équilibré. Cette stratégie permet de répartir arbitrairement les biens structurants de la famille (société, maison familiale…) et de rééquilibrer les parts avec les biens compensatoires, de moindre importance, très souvent de l’argent. Cette stratégie permet de mettre en œuvre des stratégies familiales au service d’un (et non d’une) héritier.
Dans le cas d’une succession d’une boulangerie du sud-ouest, afin que l’héritier mal puisse hériter du bien structurant qu’est la boulangerie, et garantir une égalité avec les autres héritières, celles-ci bénéficierait de croissants et pains au chocolat gratuitement pour une durée de 10 ans, démontrant les montages parfois absurdes pour garantir la stratégie familiale.
La comptabilité inversée s’accompagne très souvent d’une sous-évaluation de la valeur des biens structurants ou d’une exclusion de dons du périmètre de l’héritage afin de maintenir des parts équilibrées entre les successeurs-euses. Coller à la stratégie familiale et donc ne pas dénoncer ce déséquilibre est la position dans laquelle se résignent les descendantes au nom de la paix de la famille. On voit bien comment, à l’ombre des offices notariaux, il est aisé de contourner la loi pour permettre de favoriser un héritier au détriment d’une autre. Dans la grande majorité des cas, les biens structurants reviennent à un homme. Bien qu’attaché à la réserve héréditaire, les notaires recherchent avant tout le consensus.
La comptabilité inversée se retrouve également lors des divorces, cette fois mise en œuvre par l’institution judiciaire. Ainsi, les magistrat-es, lors de la liquidation du régime matrimonial, mettent tout en œuvre pour par exemple préserver une entreprise en l’attribuant d’office à l’ex-mari et cherchant un moyen de compenser. Cela est d’autant plus injuste pour les ex-femmes qu’il arrive que l’entreprise familiale dépose le bilan par la suite, faute de pouvoir subvenir à l’embauche de salarié-es pour prendre en charge le travail gratuit auparavant effectué par l’ex-conjointe. Il s’agit de la même logique pour les pouvoirs de vote au sein des entreprises, comme le cas de Bezos, où la préservation pour l’ex-mari prime sur les droits de l’ex-femme. Ce procédé témoigne d’une représentation masculine du capital et, plus spécifiquement, du capital productif.
Les tribunaux, chargés d’homologuer les conventions de divorce, ne se positionnent pas en garants de l’égalité entre les ex-conjoint-es. Par manque de temps, et par manque de moyens, dans la grande majorité des cas les magistrat-es se contentent d’homologuer les conventions, sans entrer plus que cela dans les détails de la répartition. De la même manière, les magistrat-es chargé-es de fixer la prestation compensatoire, très majoritairement au bénéfice de l’ex-épouse, ont également recours à une comptabilité inversée. Au lieu de calculer celle-ci en fonction des droits et besoins de l’ex-conjointe, ils se concentrent avant tout sur les capacités de l’ex-conjoint, devenant le critère central, au détriment des femmes. D’autant que les magistrat-es ne prennent en compte que le capital numéraire et disponible. Il apparaît hors de question d’entamer la propriété des biens de l’exconjoint. Cette sacralisation empêche, à l’occasion du mariage, un rééquilibre de patrimoine entre les hommes et les femmes. Les autrices pointent que « les revenus masculins sont préservés, parce que le travail masculin est doté d’une valeur morale particulière. Il s’agit, au nom de l’intérêt de l’enfant, de préserver l’image d’un père qui travaille et gagne sa vie, double condition d’une dignité masculine ». Pendant ce temps, les mères sont présupposées être disponibles pour leur enfant, témoignant des attentes genrées de l’institution judiciaire sur le rôle des parents. Double punition pour les mères et ex-conjointes, qui ne peuvent percevoir une indemnité à la hauteur mais doivent sacrifier leur temps de travail pour élever leur enfant. Ce préjugé de rôle s’explique par le décalage entre les professionnel-les du droit et les justiciables, notamment les moins fortuné-es.
Dans le cadre d’un divorce, où l’ex-femme issue de classes populaires demandait à ce que son ex-mari garde plus les enfants, pour qu’elle puisse travailler, l’avocate, issue de classes supérieures, lui suggère d’engager une nounou, chose hors de portée de la cliente, marquant ce décalage des réalités.
Une recomposition des discriminations à l’heure de la féminisation
de l’institution judiciaire en charge du droit de la famille : un
‘règlement de compte’ entre les pôles des classes dominantes ?
Par manque de temps et de moyens, l’institution judiciaire est très réticente à remettre en cause les conventions de divorce par consentement mutuel négociées entre les parties et les professionnel-les du droit, et ainsi rééquilibrer des comptabilités sexistes. En ce qui concerne les prestations compensatoires, le montant fixée par le JAF (Juges aux Affaires familiales) est un instrument de rééquilibrage économique. D’autant qu’une majorité de femmes compose cette division du tribunal, l’on pourrait donc s’attendre à une discrimination moindre envers les femmes.
Pourtant, dans les salles d’audience, se règle une opposition de classe, déplaçant la question du genre au second plan. Les résultats d’enquêtes montrent que les JAF sont réticent-es à fixer des prestations compensatoires. Cela serait considéré comme « hors d’âge » dans une société où l’égalité professionnelle est possible. Cet argument ne prend cependant pas en compte tous les sacrifices faits par les femmes, le travail reproductif et domestique réalisé au sein du couple pour permettre au mari de réaliser une carrière professionnelle. Au-delà de la pertinence ou non de cette analyse, celle-ci s’explique par la trajectoire des JAF, notamment celle des plus âgées. Il s’agit de femmes qui ont réalisé de brillantes études et de longues carrières, tout en assumant le travail domestique, les congés maternels et les mutations du conjoint. Par de nombreux sacrifices, notamment de la vie de famille, et en externalisant le travail domestique, celles-ci ont réussi à mener une carrière professionnelle. Dès lors, cette fraction dominée de la classe dominante, avec un fort capital culturel, est très sévère avec celle qui lui est opposée, composée de femmes au capital économique élevé. Elles rechignent donc souvent à accorder des prestations compensatoires à des femmes au foyer fortunées. Ici prévaut un clivage entre pôle culturel et pôle économique de la bourgeoisie. Une présidente de la chambre de famille d’une Cour d’Appel :
« Ici, on est peu généreux en prestation compensatoire […]. Le mariage, ce n’est pas une rente ! On n’est plus au XIXe siècle ! Les femmes qui n’ont jamais travaillé pour s’occuper de leurs enfants et ont sacrifié leur carrière pour que leur mari fasse la leur, ça ne nous attendrit pas, ça ne nous convainc pas. Nous sommes de gros travailleurs ici ! ».
Cette vision de la réalité sociale, selon laquelle les femmes peuvent (et doivent) assurer leur indépendance financière, est faussée. Ce mépris pèse de tout son poids sur les femmes qui n’atteignent pas l’indépendance financière, même si cela les dessert au moment du divorce. Le refus de fixer des prestations compensatoires contribue, in fine, à appauvrir les femmes.
Le système judiciaire apparaît alors largement inefficace pour atténuer les inégalités économiques de genre. Cela est d’autant plus vrai que la tendance chez le législateur est à l’extrajudiciarisation des procédures de divorce, puisque les divorces hors tribunaux concernent plus de la moitié des couples. Et, dans la grande majorité des divorces contentieux, le jugement sur le fond a lieu avant la liquidation du régime matrimonial chez le notaire, ce qui fait que le juge n’a pas d’informations ni de poids sur la question.
La situation économique post-divorce des femmes est très complexe. Dans la majorité des cas en charge des enfants, les familles monoparentales sont dans une très forte précarité. Ces mères sont les principales victimes des séparations, étant souvent socialement déclassées. Les aides sociales en France deviennent incontournables pour certaines, qui supportent la charge administrative et se retrouve une nouvelle fois en position de « mendiante » : face au juge, face à l’ex-conjoint (pensions alimentaires) et enfin face à l’administration, tandis que l’homme constitue la figure du « bon prince » qui prend en charge son ancienne famille à la sueur de son front, en tant que bread-winner. Ces aides sociales spécifiques ne sont cependant plus garanties en cas de remise en couple. Cela maintient une nouvelle fois les femmes en position de soumission, soit face à l’État, soit face à un nouveau conjoint.
Pour autant, les pensions alimentaires, par la comptabilité inversée, sont souvent faibles et ne couvrent pas les besoins de la mère. Cela répond à une logique de préservation des ressources de l’ex-conjoint pour sa nouvelle famille. C’est ce que résume la réplique d’une juge : « Il travaille, il a cinq enfants. La pension alimentaire est adaptée par rapport à ses revenus, peut-être pas par rapport à vos besoins. Je pense que ce qu’il propose est correct. »
De la même manière, en ce qui concerne la garde des enfants, et donc la disponibilité des mères pour travailler, la vision genrée des juges va faire peser cette charge sur les ex-femmes. Une juge tient des propos sans équivoques à ce propos :
« Moi, je suis surprise par les papas, dans un sens ils se débrouillent quand même vachement pour prendre leur enfant, y compris quand ils ont des métiers [prenants]. Alors des fois, ce n’est pas tous les mercredis, c’est un mercredi par mois, mais bon, moi, je trouve que c’est déjà un bel effort, parce que bon, on fait pas toujours comme on veut, et je pense que ça conduit à des sacrifices au niveau financier pour eux aussi […].
[L’enquêtrice]« Et ce matin, la dame qui explique : “il faut que je travaille, il faut qu’il le prenne plus souvent”, est-ce que vous avez déjà entendu ça ? »
[La juge] « Celle-là, elle m’a bien surprise ! J’avais l’impression que son gamin, c’était une patate chaude, et qu’il fallait qu’elle s’en débarrasse pour aller travailler. Ça m’a un peu… j’étais à deux doigts de lui dire, mais je me suis dit, bon, elle est énervée, on ne va pas non plus en rajouter… Mais ça m’a choquée, moi, personnellement. Parce que, bon, je comprends bien que ça lui pose des difficultés, mais voilà, il y en a d’autres, des mamans célibataires, faut se débrouiller, quoi, les modes de garde… […] Elle m’a choquée, je vous dis, ça m’a [soupir]… ç’aurait été le père, j’aurais été plus… C’est sexiste de ma part, mais bon, c’est vrai qu’on comprendrait plus. »
Pour conclure comme les autrices ont conclu leur dernier chapitre, « Esclave entre tous est l’ex-femme du prolétaire, assignée au travail domestique gratuit et condamnée à être dépendante financièrement soit de l’État, soit d’un nouveau conjoint ».
Cette série d’articles est le fruit d’un travail réalisé en collaboration avec Louis B-F.