En 1978, une nouvelle intrigante parcoure la Russie des chercheurs et des anthropologues : en Sibérie, une famille vivant en autarcie totale a été retrouvée. Les enfants n’ont même jamais mangé de pain ni de sel, nous dit-on. Derrière cette nouvelle sensationnelle et presque voyeuriste, se cache une réalité historique russe, celle d’un schisme religieux.
En 1653, Pierre 1er (« le Grand ») et le patriarche Nikon entreprennent une vaste campagne religieuse. Il s’agit de traduire à nouveau du grec tous les textes liturgiques et religieux du culte orthodoxe, afin de rectifier certaines erreurs. De ce mouvement de traduction, découle une correction de la pratique des rites. Un exemple : les russes, qui se signaient avec deux doigts, doivent désormais le faire avec les trois doigts, comme les grecs. Cela produit de vifs remous dans les consciences, et beaucoup considèrent que ces nouvelles habitudes sont hérétiques. S’en suit un schisme entre les pratiquants qui acceptent ces nouvelles formes, et les « vieux croyants » qui refusent ces nouvelles pratiques. Les Lykov, cette famille « découverte » en 1978, est héritière de ces « raskoloniki » ces individus schismatiques, qui continuent tant bien que mal d’exister dans la Russie soviétique, peu portée sur les questions religieuses.
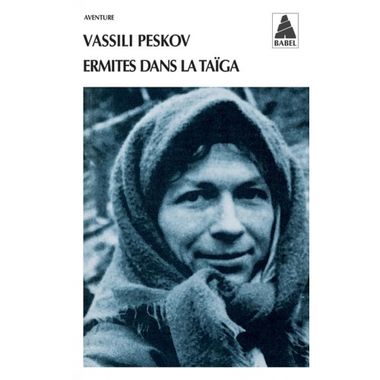
L’auteur a l’occasion de visiter la famille à partir de 1982, et régulièrement pendant une période de dix ans. Il s’attache à décrire le quotidien de ces gens, ainsi que les spécificités de leur mode de vie de vieux croyants. Notons ici quelques aspects de cette vie. D’abord, les Lykov n’acceptent rien qui ait été produit « dans le siècle » c’est-à-dire dans le monde séculier et non religieux. Tous les objets manufacturés leur sont donc étrangers, de même que les moyens modernes d’éclairages. Ils n’ont jamais fréquenté d’école, n’ont pas de papiers d’identité et refusent toute forme de photographie.
Le récit de Peskov est intéressant à plus d’un titre, et révèle certains tropes de l’écriture ethnographique. D’abord, on ne peut s’empêcher d’être attiré par la découverte de cette famille autarcique et l’on a envie de tout connaître sur leur mode de vie. Il y a là une certaine forme de voyeurisme, qui transforme cette famille en phénomène incroyable. Parler d’eux consiste à atteindre le succès par le sensationnel, l’exception. Ce phénomène n’est pas nouveau, mais à un goût amer qui nous renvoie à ce qui s’est fait de pire dans l’anthropologie, avec notamment la doctrine évolutionniste et l’idée selon laquelle « nous » sommes plus évolués « qu’eux ». Le texte n’a pas ce défaut, cependant, pour qui a étudié l’histoire de l’anthropologie, ces questions ne sont pas exemptes d’un précédent.
De plus, au cours du roman, la famille devient de plus en plus proche d’une base géologique ainsi que d’autres personnes appartenant au « siècle », ce qui change considérablement leurs habitudes. Comment considérer cette aide extérieure ? La famille elle-même a d’abord du mal à recevoir ces dons, car ils ne correspondent pas à leur mode de vie. Cependant, ils déclarent peu à peu devenir vraiment dépendants de ces derniers, à tel point qu’ils ne pensent plus être capables de survivre sans eux. Cette volte-face, pourtant impensable du fait des croyances religieuses des Lykov, permet de s’interroger sur la possibilité de la vie en autarcie.
Certes, le lieu d’élection de l’ermitage des Lykov est situé dans une région particulièrement dure. La famille est entièrement dépendante des ressources qu’elle est capable de produire ou de récolter, dans un monde où l’hiver est omniprésent. Loin des récits survivalistes bienséants qui fleurissent dernièrement, cette histoire met l’accent sur la difficulté à se nourrir, et ce qui en découle : la maladie, voire la mort. C’est bien de faim qu’est morte la mère en 1961, et les douleurs de ventre péniblement décrites par les survivants n’augurent rien de bon quant au régime de la famille, manquant de sel, de viande, de fruits et légumes frais, de céréales, et ce pendant une bonne partie de l’année.
Attention, ce récit n’est pas une incitation à se sentir bien dans sa chaumière, à montrer la difficulté du monde extérieur pour louer le confort moderne. Cela est difficilement réalisable par un auteur russe de cette époque. Ce n’est pas non plus ce en quoi nous croyons. Montrer, en revanche, que la survie est une matière sérieuse et non un rêve de paradis n’est pas en trop.
Un élément marquant de cette affaire est que les quatre enfants n’ont jamais connu l’école. Ils ont donc appris à parler grâce à d’ancien livre religieux, transmis depuis des générations chez les Lykov. Le langage est un élément classique d’analyse de terrain ethnographique, et le langage Lykov attire tout de suite l’attention. L’auteur évoque au début du livre l’entretien qu’a eu une géologue avec les deux filles de la famille, Natalia et Agafia. Elle se souvient particulièrement de leur langage étonnant, empli de mots dont elle ne connaissait pas elle-même l’existence, qu’ils soient archaïques ou étrangers (parfois mongoles). Les enfants ne parlent pas un slave du xviie siècle, comme cela a pu être dit de manière erronée, mais seulement une forme très archaïque de la langue russe, qu’un locuteur élevé dans le monde soviétique ne peut que difficilement comprendre. Des chercheurs spécialisés en linguistiques sont d’ailleurs venus visiter l’ermitage.

Ce roman lance un certain nombre d’hypothèses et de questions, qui restent en suspens. Tout d’abord, le roman reste très pudique sur la question des relations sexuelles des personnages. Les parents ont eu quatre enfants, deux filles et deux garçons qui ont vécu ensemble jusqu’à la trentaine. La question de l’inceste mérite d’être posée, puisqu’elle vient automatiquement à l’esprit dans ce genre de cas. On le sait depuis Levi-Strauss ; toute société se fonde sur la prohibition de l’inceste. Qu’en est-il de cette société restreinte ?
Manifestement, la question est difficilement abordable avec des êtres chez qui foi et pudeur sont si fortes. La seule action qui nous indique un problème de ce genre est la décision du patriarche d’installer ses deux garçons dans une isba éloignée de six kilomètres de la l’isba principale. Cependant, on apprend que les trajets sont quand même presque quotidiens entre les deux et que les hivers sont vécus ensemble.
Un autre problème est la question de la survie d’Agafia, une fois que son père et tous les siens seront morts. Agafia est la personne autour de laquelle le récit se compose. On admire sa force et son courage, mais également sa ténacité et son charisme. Plusieurs fois, elle n’hésite pas à faire des trajets en hélicoptère et en avion, elle qui refuse même de se laisser prendre en photo. Son père, le seul autre survivant de la famille, est âgé, et la question de la survie de la jeune femme est un problème pour ses proches. Survivre seule dans la taïga est pratiquement impossible, d’autant plus que la base géologique voisine s’apprête à mettre la clef sous la porte.
Plusieurs possibilités s’ouvrent à Agafia : aller rejoindre des parents dans le « siècle » ou rejoindre des religieuses cloitrées plus au nord. Ces projets vont même jusqu’à une tentative de mariage avec un cousin éloigné. On comprend rapidement que ce n’est pas une bonne idée. Le récit se termine sans nous dire ce qu’il est en de cette question, mais en affirmant qu’Agafia refuse de quitter son ermitage et que son destin repose, selon son souhait, entre les mains de Dieu.
