Interview de Romain Toutain, directeur technique de la franchise Mass Effect

Directeur technique chez Bioware en charge de la franchise Mass Effect, Romain Toutain est passé auparavant chez Supermassive Games, Square Enix, Splash Damage ou encore Arkane Studios. Pour Le Tote Bag, il a accepté de revenir sur son parcours, mais aussi le crunch qu’il a pu vivre au cours de sa carrière, son regard sur l’évolution de l’industrie vidéoludique… Ayant dirigé plusieurs entretiens, il nous partage aussi ses conseils pour quiconque voudrait se lancer dans ce domaine.
Pour des raisons évidentes de clause de non divulgation, cet entretien n’aborde pas les projets en cours chez Bioware.
Le Tote Bag : Romain, bonjour et tout d’abord merci de me consacrer ce temps, alors que ton planning de travail ne désemplit pas pour ne pas dire qu’il déborde.
Romain Toutain : Aucun problème, ça me fait plaisir.
LTB : Peux-tu te présenter brièvement et nous expliquer ton poste actuel chez Bioware ?
RT : Je m’appelle Romain Toutain, je suis directeur technique de la franchise Mass Effect chez Bioware. Pour préciser ce que signifie cette qualification, j’ai la responsabilité technique de tout ce qui peut toucher de près ou de loin à Mass Effect, notamment concernant le prochain jeu de la série. Techniquement, si quelqu’un utilise un de nos outils de développement c’est ma responsabilité. Je gère les équipes de développement en interne, les relations avec les groupes d’Electronic Arts, et j’ai sous ma responsabilité les équipes de programmation.
Pour me présenter, j’ai 40 ans, j’ai eu mon premier poste officiel dans le jeu vidéo en 2004, ce qui commence à remonter. Avant ça, j’ai toujours développé des jeux vidéo de mon côté, avec des petits contrats à droite à gauche. J’ai aussi fait partie de la scène homebrew.
LTB : Pour nos lecteur·ice·s qui ne sauraient pas ce qu’est le homebrew, pourrais-tu l’expliquer ?
RT : le homebrew c’est tout ce qui est développement indépendant sur console sans utiliser les outils officiels. Contrairement à ce qu’on pourrait croire ce n’est pas spécifiquement du piratage. La majorité des personnes qui font du homebrew sont des développeurs de jeux vidéo qui travaillent déjà dans le milieu. Le but en soi n’est pas le challenge technique de pirater les consoles pour y utiliser des versions illégales des jeux, même si certains outils de homebrew peuvent le permettre. Pour quelqu’un qui veut s’amuser à créer et développer des jeux de son côté, c’est un moyen de transformer sa console en kit de développement, un outil habituellement remis directement aux studios de développement pour créer des jeux compatibles avec le support.
LTB : Quand as-tu commencé à développer des jeux vidéo de ton côté ?
RT : Très tôt. C’est quelque chose que j’ai toujours voulu faire et qui m’a toujours attiré et fasciné. À l’époque des magazines papier sur l’Amstrad ou l’Amiga, on pouvait y trouver des listings de jeux que l’on pouvait copier. C’était long et fastidieux, mais il suffisait de recopier le code source, souvent en BASIC (un langage de programmation), pour avoir le jeu gratuitement. Ça a été mes premiers pas dans la programmation, et depuis je n’ai jamais arrêté. Tu tombes dedans à force, en analysant ce que tu recopies et en te demandant « et si je veux ajouter un 2e joueur ou modifier la hauteur des sauts, peut-être qu’en changeant ça et ça et en ajoutant une ligne comme ça on peut y arriver ». Et de fil en aiguille tu finis par créer ton propre niveau, à force de tout modifier et de comprendre le lien entre une ligne de code et ce que ça peut donner. Après ça peut paraître fou aujourd’hui mais à l’époque la plupart des ordinateurs étaient vendus avec un manuel du BASIC. Donc j’avais toutes les clés en main pour commencer à apprivoiser ce langage.
Je me souviens que j’allais faire les courses des voisins pour me faire de l’argent de poche et espérer acheter un vieil Apple II dans un vide-grenier. Je me suis bien abîmé les yeux devant son écran vert à phosphore en passant des heures à écrire des lignes de code. Mais ce qui est fou c’est qu’avec l’ordinateur j’ai aussi récupéré des Floppy Disk qui n’étaient pas vide. Ils contenaient des jeux codés par un développeur indépendant ! Par la suite, j’ai continué à programmer des jeux parce que c’était ma passion. À l’époque, dire à tes parents que tu voulais devenir développeur de jeux vidéo c’était comme leur annoncer que tu voulais devenir acteur à Hollywood ou chanteur, c’était difficile de percevoir ça comme autre chose qu’une lubie sans grand avenir. D’autant plus qu’il n’existait aucune formation universitaire précise pour se diriger vers ce domaine.

LTB : Justement, en l’absence d’école spécialisée et à une époque où ce milieu n’avait pas du tout la même reconnaissance qu’aujourd’hui, qu’est ce que tu as suivi comme cursus ?
RT : Après le lycée, j’ai fait des études d’électronique. C’était le seul endroit où l’on pouvait faire de la programmation. Donc j’ai commencé par de la programmation sur microcontrôleur et microprocesseur. Mais c’était comme un rêve ! Et à un moment tu réalises que c’est les mêmes processeurs qu’il y a dans certaines consoles de salon. Et c’est ça qui m’a amené au homebrew
LTB : Au cours de tes pérégrinations dans le milieu du homebrew, est ce que tu en es arrivé à faire de la demoscene ?
RT : Pour celles et ceux qui ne le sauraient pas, la demoscene c’est comme un concours, un regroupement, où des programmeurs viennent présenter des applications, des logiciels, qui font des effets visuels repoussant les limites du support sur lequel ils sont développés. La demoscene historique, que je n’ai pas connu, est celle de l’Amiga. Pour ma part j’ai attendu d’être au lycée, et dans mon internat j’ai rencontré un gars qui faisait de la demoscene. C’est comme ça que j’ai mis un premier pied dedans. À ce moment là, tu réalises que, si de ton coté tu es déjà très content de ce que tu crées et que t’amuses bien, il y a des gens qui inventent des choses complètement folles. Pour quelqu’un comme moi, encore en phase d’apprentissage, c’est quelque chose qui te tire vers le haut. Tu apprends des astuces, des moyens de détourner les outils que tu as à ta disposition pour te faciliter la vie et gagner en temps et en possibilités. Au fil des évènements, j’ai pu rencontrer des personnes qui travaillent encore dans le jeu vidéo aujourd’hui, chez Remedy, Housemarque, Rockstar… Si on cherche, on peut trouver des anciens de la demoscene quasiment partout.
LTB : Après tout cela, comment as-tu obtenu ton premier poste officiel dans le jeu vidéo ?
RT : J’ai commencé par des portages pour mobile et d’autres supports, mais c’était il y a plus de 20 ans, avant que je ne trouve un travail à temps plein. Mon premier poste, je l’ai eu dans un studio d’une vingtaine de personnes à Paris. L’employeur cherchait un lead programmer et m’a demandé de venir avec mes propres créations. De mon côté, j’avais codé des effets de demoscene en homebrew sur ma Nintendo DS. Je lui ai montré quelques effets et il m’a embauché. À l’époque, le gros marché c’était les jeux Nintendo DS. Tu pouvais y trouver tout et surtout n’importe quoi. La société pour laquelle je bossais recevait des demandes de gros éditeurs comme Ubisoft pour des petits jeux, principalement destinés aux enfants. Donc j’ai codé des papouilles sur des poneys et de très beaux thermomètres rectaux à usage vétérinaire. J’ai travaillé sur des jeux Paris Hilton, Alexandra Ledermann ou Foot 2 Rue qui n’ont pas particulièrement bien vieillis. Il faut imaginer qu’à l’époque c’était un, voire deux programmeurs par projet avec plusieurs commandes en parallèle. Il fallait souvent se débrouiller tout seul. Mais c’est ce que je voulais faire, créer des jeux, écrire du code moteur etc. Donc j’étais content.

LTB : Et tu continuais à coder pour toi sur tes temps libres ?
RT : Toujours. Même maintenant. Je continuais le homebrew, tout en travaillant des simulations de vétérinaire et c’est ce qui m’a amené à mon poste suivant. Par la scène homebrew, j’ai rencontré le directeur technique du studio français Arkane (Arx Fatalis, Dishonored, Prey, Deathloop…) qui faisait du homebrew sur Game Boy Advance. Lorsque le studio où je travaillais a fermé, je me suis renseigné auprès de mes contacts pour savoir s’ils embauchaient et j’ai décroché un poste de programmeur graphique chez Arkane. Ce qui fait que le premier gros jeu sur lequel j’ai travaillé c’est Dishonored. Une expérience incroyable, j’ai énormément appris là-bas, entouré de gens extrêmement talentueux, avec des idées incroyables. Je suis parti un peu avant la fin du développement, au moment du rachat par Bethesda, parce qu’on m’a proposé un poste en Angleterre, et avec ma conjointe on voulait bouger.
LTB : C’est là que tu as démarré chez Splash Damage (Brink, Dirty Bomb, Gears of War Ultimate…) ?
RT : Exactement. Toujours comme programmeur graphique. On a déménagé à Bromley, dans la banlieue sud de Londres. À l’époque, Splash Damage travaillait sur un moteur maison, dérivé de Id Tech (Doom 3 Engine) et ils cherchaient des personnes qui voulaient faire de l’implémentation console du moteur. À ce moment-là, le studio travaillait sur Brink, qui a eu un succès critique mitigé. Ensuite j’ai été promu en tant que Lead Core Tech, donc je m’occupais de toute la partie moteur graphique, audio et online. Après Brink, on a travaillé sur plusieurs projets qui n’ont jamais vu le jour, dont des jeux Marvel. Dans les projets qui ont abouti, il y a eu Dirty Bomb, un FPS compétitif, mais aussi toute la partie multijoueur en ligne de Batman Arkham Origins. C’était une période où tous les jeux devaient avoir un mode multijoueur. Heureusement on en est un peu sorti. On ne s’en rend pas forcément compte mais c’est extrêmement compliqué de programmer un mode multijoueur en ligne. C’est comme si on avait deux jeux complètement séparés. Par la suite, nous avons été contacté par Microsoft qui avait racheté la licence Gears of War pour faire le mode multijoueur de Gears of War Ultimate. Et finalement on a pu développer le jeu dans sa globalité.
LTB : Et au bout de 7 ans, une nouvelle aventure, bien différente.
RT : Oui. Alors, à ce moment-là j’étais très fatigué, vraiment épuisé, et j’avais aussi envie de voir autre chose. J’ai obtenu un poste en tant que directeur technique chez Square Enix, qui a une branche européenne située à Londres qui s’occupe de la supervision des projets, côté éditeur. J’ai découvert une toute autre facette du jeu vidéo, du côté de l’édition. Et ça n’a rien à voir avec le développement. Je me suis retrouvé à travailler sur plusieurs projets en même temps, la licence Life Is Strange, Outriders, Just Cause 4… Mon rôle était d’aller visiter tous les studios régulièrement pour faire de la production, de l’organisation, des choix de technologie, pour essayer au mieux de faire sortir les jeux dans les temps. J’ai passé la moitié de mon temps dans des avions. C’était énormément de collaboration et un rôle d’intermédiaire entre les studios de développement et l’éditeur, Square Enix. C’était extrêmement intéressant, ça m’a permis de voir différentes méthodes de travail, différentes équipes, de comprendre leur fonctionnement et d’essayer d’en tirer le meilleur. Ça m’a aussi permis de voir la création d’un jeu mais du côté de l’éditeur, la gestion des ressources etc. Mais je me suis rendu compte que ce n’était pas pour moi. Je ne pouvais pas rester aussi loin des projets.
LTB : D’où ton retour aux sources, dans l’horreur, mais dans le bon sens du terme.
RT : *rires* On peut dire ça. Au moment où je voulais vraiment retourner au cœur du développement, Supermassive Games (Until Dawn, The Dark Pictures, The Quarry…) cherchait un directeur technique. Ils m’ont contacté et après un entretien j’ai reçu une offre que je n’ai pas accepté immédiatement parce que j’avais aussi d’autres opportunités. Mais j’ai fini par signer chez eux, pour y rester 3 ans en tant que directeur technique sur The Dark Pictures, un projet particulier de plusieurs jeux. On avait un jeu en fin de développement pendant qu’un autre était en milieu de prod’ et qu’un 3e était carrément en pré-prod’. Donc j’avais un pied dans chaque projet, ce qui impliquait d’avoir… trois pieds. Mais retrouver le dev floor ça n’avait pas de prix. J’avais le code source du jeu, j’implémentais du code etc. En arrivant là-bas, après mon expérience plus « mobiles » et disparates chez Square Enix, je me suis dit « ouais, c’est là que je veux être en fait ». En plus c’était pour bosser sur des jeux d’horreur, un de mes genres préférés.

LTB : Effectivement, tu étais pleinement dans ton milieu, même au niveau de l’entourage professionnel.
RT : Souvent dans les équipes de développement, tu trouves des gens passionnés par l’univers dans lequel se passe le jeu sur lequel ils travaillent. Par exemple, là je bosse sur Mass Effect, et quand j’évoque un livre, une série ou autre, de science-fiction que je découvre ou dans laquelle je me replonge, ils la connaissent déjà. Parce que c’est ce qu’ils aiment. C’est comme au lycée quand tu tombes enfin sur un groupe de « nerd » qui s’avère avoir les mêmes centres d’intérêt que toi. C’est une convergence des passions qui est plaisante, rassurante (surtout au lycée), et ça permet d’approfondir tes propres connaissances sur le sujet. Chez Supermassive Games c’était la même chose mais avec l’univers de l’horreur, qui est plus niche que la S-F. Je me souviens de mon lead programmer qui avait une collection de dvd et de blu-ray de nanars horrifiques, c’était fascinant et contagieux. Au final ça te crée un environnement de travail vraiment positif et motivant.
Mais au bout d’un moment, avec ma conjointe on voulait quitter l’Angleterre pour diverses raisons. Et après avoir laissé entendre que j’allais probablement vouloir bouger, j’ai reçu différentes propositions (Housemarque, Remedy…). Mais lorsque j’ai eu l’opportunité de travailler chez Bioware, sur le prochain Mass Effect, j’ai regardé ma veste estampillée N7 (code de désignation qu’on retrouve sur les équipements et le vaisseau principal de la trilogie Mass Effect), que j’ai depuis des années et je me suis rendu à l’évidence.
LTB : Ton parcours est parsemé de belles rencontres, d’opportunités en or et de souvenirs impérissables. Mais je sais aussi que tu as vécu des périodes très difficiles, et notamment un phénomène malheureusement encore présent dans le milieu des studios de développement, le crunch. Est-ce que tu accepterais de nous raconter un peu comment tu l’as subi et vécu de l’intérieur ?
RT : Juste pour les personnes qui ne connaîtraient pas ce terme, le crunch c’est, grosso modo, des heures supplémentaires obligatoires, sur une longue période, sans possibilité de congés. On va te dire « Pour respecter nos engagements, il va falloir que tu fasses 3h en plus tous les jours ». Et sur le coup on ne s’en rend pas réellement compte, mais sur un semestre ou une année, 3h par jour en plus, ça fait beaucoup. Et après on te demande de faire 4h en plus, puis de venir les week-ends… Quand j’ai commencé dans le jeu vidéo, tout le monde crunchait. Tout le temps. Dès mes premiers jobs, on était une petite équipe mais on était au boulot jusqu’à minuit parce qu’il fallait livrer le produit, respecter des dead line imposées. Au début tu ne t’en rends pas compte parce que tu es avec tes potes, tu es payé pour pratiquer ta passion. En plus, à l’époque j’étais célibataire donc ça ne me posait pas de problème. Et un jour tu prends un peu de recul, tu réalises que certes c’est ta passion, certes tu t’en accommodes, mais en réalité tu n’as pas le choix. On te fait comprendre que c’est la norme et que si tu ne le fais pas, tu peux compromettre la sortie du jeu. Mais le piège c’est que quand tu en parles autour de toi, tu as l’impression que c’est tellement commun que c’est la norme. Tu as presque du mal à te plaindre parce que tu fais un truc que tu adores, donc ton sentiment est très ambivalent. C’était à l’époque où je travaillais sur des portages pour la Nintendo DS. Après chez Splash Damage, changement de pays, plus grosse boite, ça a pris une toute autre tournure. Le crunch était devenu constant et vraiment brutal. Pendant 6 mois, ou un an, tu bosses tous les week-ends, et tous les soirs jusqu’à minuit, une heure du matin. Tu rentres chez toi, tu vas dormir quatre heures et tu y retournes.
LTB : Quand tu es à ce point enfermé dans ce schéma toxique de travail, tu réalises que quelque chose ne tourne pas rond ?
RT : Pas du tout. Tu te rends compte que, toi, tu ne vas pas bien, tu te rends compte que tu fais trop d’heures mais tu te dis que ce n’est pas grave. Chez Splash Damage c’est quelque chose qui a heureusement évolué, mais quand je suis arrivé en cours de développement sur Brink, les équipes étaient en crunch depuis déjà un an, et je suis tombé en plein dedans. Et pour rappel, pas de congé. Ce qui amène à des situations ubuesques, où quand j’ai quitté Splash Damage j’avais cumulé 300 jours de congés non posés. Parce qu’au bout d’un moment ils ont créé un système où pour un jour de travail en plus, au cumul d’heures supplémentaires, tu récupérais une demi-journée de congés… que tu ne pouvais pas poser. Et puis tu finis un projet, et tu enchaines le suivant sur le même système. Après avoir sorti Brink, on a enchainé sur Batman Arkham Origins, et là ça a été un an et demi de crunch où j’ai dû poser un seul jour off, en comptant les week-ends. Le problème c’est qu’à l’époque c’était difficile de recruter, donc tu ne pouvais pas simplement embaucher pour mieux répartir les tâches et l’accumulation de travail.
LTB : Mais niveau santé physique et psychique c’est intenable.
RT : Ah ben non, pas du tout même. On a des gens hyper talentueux, des vrais passionnés qui se sont barrés. Et pas seulement du studio, mais qui ont quitté le monde du jeu vidéo, dégoûtés et lessivés. Maintenant ils codent des logiciels de comptabilité, ils font des horaires normaux, ils voient leurs enfants et ils sont mieux payés. De mon côté j’ai fait un burnout très sévère après Gears of War Ultimate où pendant presque un an j’ai eu énormément de mal à travailler. J’ai été arrêté, j’ai repris en quart temps, puis à mi-temps très progressivement, mais avec un suivi médical strict à côté et des traitements pour réussir à me relever. Le crunch, c’est dangereux, c’est pernicieux, on ne s’en rend pas compte, on se répète « on va y arriver », mais à un moment on relève la tête, et on réalise ce que ça nous a coûté.
Quand je dis que c’est pernicieux c’est que tu te fais piéger par ta passion. Quand on te dit « tu vas être lead programmer sur Gears of War », tout ce que tu penses c’est que tu as de la chance d’avoir cette opportunité. Et pour être honnête, on a fait des trucs de dingue, d’un point de vue créatif c’était incroyable. Mais ave un an de plus on aurait pu le faire sans ruiner la santé des équipes. Et ce qui fait qu’on n’a pas pu le faire en un an de plus c’est en lien avec le marketing de la console. Gears of War 4 allait arriver aussi et compte tenu du temps qui nous séparait de la sortie du dernier opus, il fallait sortir ce remaster pour permettre à une nouvelle génération de joueur et joueuses de découvrir cet univers sans être rebuté par le fait d’attaquer directement par le 4e jeu de la série. En fait le problème c’est qu’à un moment tu as un producteur exécutif qui dit « ok, on le fait pour telle date » et à partir de là tu es coincé.
LTB : Tu me disais, quand on a préparé cet interview en amont, que la passion était aussi un piège, au-delà du crunch lui-même.
RT : Le jeu vidéo reste un domaine où les gens sont passionnés par ce qu’ils font. Très souvent, tu vas y investir du temps personnel, extra-professionnel. Personnellement le soir, quand je ne suis pas avec ma famille je fais du code. Pas parce qu’on me l’a imposé, mais parce que j’aime ça. Le problème c’est que ça crée un fossé de performance entre les gens qui le font et ceux qui ne le font pas. De facto, si je passe plus de temps, au total, à programmer, apprendre et tenter des trucs, je vais être un meilleur programmeur que quelqu’un qui y aura passé beaucoup moins de temps. Comme pour jouer d’un instrument de musique ou autre. Et c’est vicieux parce que, in fine, la pratique de ta passion, durant et en dehors de tes heures de travail, ça génère un élitisme à la con. C’est pas du tout réalisé dans ce but-là, quand c’est ta passion tu te ne forces pas. Mais la disparité de maîtrise des outils que cela peut engendrer au sein d’une équipe, ça normalise le fait de continuer à travailler le soir et le week-end, pour suivre le train en marche.
Mais on retrouve ça aussi dans d’autres domaines. Dans le milieu médical, celui qui va lire des articles, se tenir au courant des nouvelles études, de la recherche, des nouvelles recommandations, il va inexorablement être meilleur que celui qui ne le fait pas. Mais pour autant, il ne serait pas normal d’imposer aux gens de continuer à baigner dans leur domaine professionnel une fois qu’ils sont en repos.
La résultante de tout ça, c’est que même aujourd’hui, où fort heureusement il y a une vraie réflexion, et une vraie dénonciation du crunch, il reste un message de fond « Oui, il ne faut pas faire trop d’heures, mais si tu pouvais continuer à te plonger un peu dans le domaine y compris sur tes jours off, ça pourrait nous rendre service, parce que tes collègues le font sans qu’on leur demande »
LTB : D’avoir vécu le crunch de l’intérieur est-ce que ça influe sur la gestion de tes équipes, maintenant que tu as un peu plus de pouvoir à ce niveau ?
RT : Bien sûr. C’est quand même plus facile maintenant, grâce à la mise en lumière et la dénonciation du crunch par les équipes de développement et les journalistes. Même si le problème n’est pas éradiqué. De mon côté, je n’ai pas un poste de gestion de groupe très marqué, je suis principalement responsable de la partie technique, et j’ai encore beaucoup le nez dans du code. Mais cette proximité ça me permet d’aider certains développeurs en les orientant vers des outils ou des méthodes d’apprentissage plus efficaces. Et surtout j’essaye d’allouer du temps pour cela sur les heures de travail. On va définir un nombre d’heures par semaine qui ne vont pas servir à travailler sur le jeu directement mais à se tenir au courant de la recherche, faire des expérimentations, implémenter un prototype, progresser dans son domaine au lieu de juste faire de l’application. Mais toujours dans le but que cela soit bénéfique pour le développement du jeu. Ça ne corrige pas complètement le problème, mais ça limite la casse.
Il y a toujours des gens qui vont te dire qu’ils veulent rester deux heures de plus pour faire des tests, tenter des implémentations. Dans ce cas, tu t’assures qu’ils le font parce qu’ils le veulent et non par obligation. Et après tu essayes de faire en sorte que ces heures-là soient décomptées pour qu’ils puissent les poser à un autre moment. Pour en revenir au crunch en lui-même, j’ai l’impression qu’aujourd’hui il y a beaucoup moins de manipulation de la passion des développeurs. Et il y a aussi le marché de l’emploi, pour certains postes, qui fait qu’en cas de chantage où on va te faire comprendre qu’il y a des gens qui aimeraient bien avoir ton poste, tu peux rétorquer qu’il y a aussi des studios qui aimeraient bien te recruter. Bref, tout n’est pas réglé, mais heureusement ça avance et j’espère que ça va continuer dans ce sens.
LTB : Dans toutes les étapes par lesquelles on passe lors de la création d’un jeu, quelle est celle où tu stresses le plus et celle que tu préfères ?
RT : Niveau stress c’est la vertical slice. Si vous ne savez pas ce qu’est la vertical slice, il faut imaginer que vous faites un gâteau, qu’on vous a commandé. Au moment où vous savez déjà quelle recette vous allez faire mais sans que ce ne soit le produit final. On s’en approche, le goût est là mais ce n’est pas sa version définitive. Vous en coupez une part, qui contient toutes les couches du gâteau. Déjà vous espérez que ça ne va pas s’effondrer une fois dans l’assiette. Puis vous amenez ça à la personne qui vous a passé commande pour avoir son aval avant de continuer de cuisiner. Donc c’est un prototype, de quelques minutes, mais avec les mécaniques les plus représentatives du jeu, que l’on présente à l’éditeur. Et à ce moment-là, tu peux très bien recevoir comme réponse « Non, ce n’est pas du tout ce qu’on voulait (ou plus ce qu’on veut), on arrête la production, le jeu est tué, salut ». Et là tu arrêtes brutalement un travail sur lequel toute l’équipe a bossé depuis 6 mois, un an ou plus.
Un autre moment de stress c’est la certification, chez Sony ou Microsoft, pour qu’ils fassent leur propre vérification sur le produit. Et là tu peux serrer les fesses pour deux raisons. La première c’est parce que tu veux que ça passe pour pouvoir passer à autre chose. La deuxième c’est quand ,au fond, tu ne veux pas que ça passe parce que tu sais qu’il y a encore du boulot à faire sur le jeu, et tu veux aimerait bien qu’on te donne le temps nécessaire, sans avoir à demander. Mais parfois ça ne marche pas, et il passe alors que tu ne voulais pas. *rires*
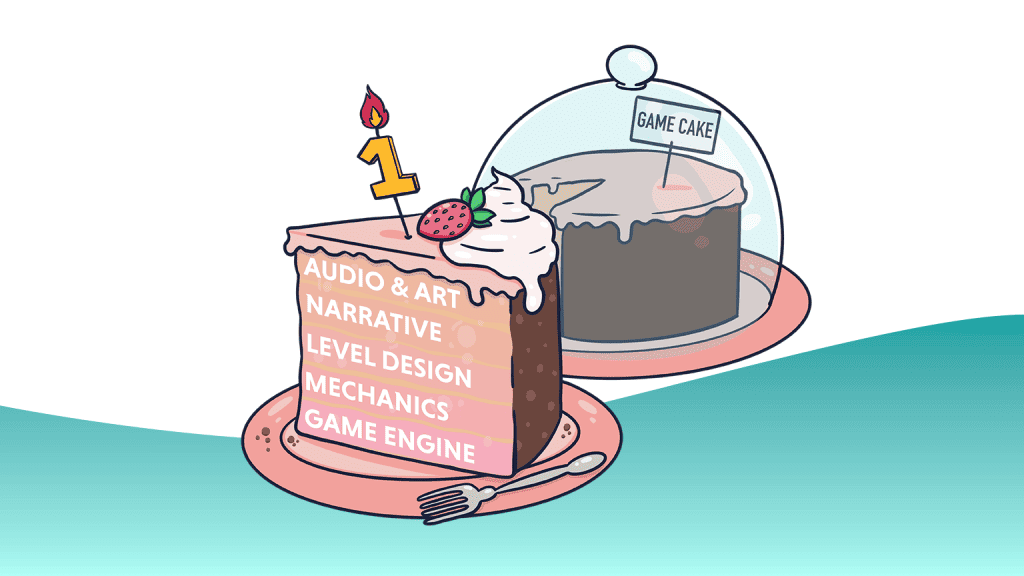
LTB : C’est intéressant que tu dises ça parce que justement, je me posais la question par rapport à certains jeux qui ont défrayé la chronique pour l’état catastrophique dans lequel ils sont sortis. Je pense à Cyberpunk 2077 sur PS4, et plus récemment le portage PC de The Last of Us. En tant que consommateur tu te dis que les studios ont testé leur jeu, ils savent que ça va être la catastrophe, du coup qu’est ce qui fait que tu te dis « tant pis, on y va quand même » ?
RT : Il y a plusieurs raisons. La première c’est la thune, le budget. T’as pas le budget pour continuer de bosser dessus, c’est fini, on envoie le jeu, et on monte une petite équipe qui s’occupe de fixer les bugs. La deuxième c’est que décaler la sortie d’un jeu c’est extremement compliqué. Tu ne peux pas juste faire un communiqué sur Twitter et changer la date sur ta page Wikipédia. Tu as des partenaires, des investisseurs, et énormément de gens impliqués dans la sortie du jeu qui ne vont pas te laisser dépasser la date de fin de l’année fiscale. Ça amène à un calcul, qui peut avoir comme résultat que sortir le jeu en l’état c’est moins pire économiquement parlant que de ne pas le sortir. Ce qui n’est pas toujours un bon calcul parce que, même si derrière tu sors des patchs correctifs et qu’au final ton jeu devient acceptable, le mal est fait. Tu entaches la réputation de la licence, du studio etc.
Et ce qui est terrible c’est que pour certains bugs, qui vont ruiner l’expérience de jeu, ça se joue à 2 ou 3 jours de plus durant lesquels les équipes auraient pu corriger le tout. Après pour parler plus spécifiquement des sorties sur PC, c’est bien plus complexe que les sorties consoles. Parce que chacun va avoir une configuration différente. Tu vas avoir ceux qui ont le PC lambda prémonté de chez FNAC, LDLC ou autre, mais tu as aussi ceux qui vont changer leur carte graphique, le processeur, installer multitudes de pilotes différents pour leur clavier, leur souris, leur manette, tuner leur ventilateur… Pour limiter la casse tu peux faire appel à des laboratoires qui vont tester ton jeu sur un très grand nombre de configuration et essayer de détecter en amont les incompatibilités qui peuvent survenir.
De souvenir, chez Splash, on a eu un bug sur un jeu, en lien avec les pilotes d’un certain type de manette. Si la manette n’était pas branchée alors que les pilotes étaient installés (donc si depuis l’installation tu avais changé de manette par exemple), le jeu perdait en framerate (la cadence d’image par seconde). Et le seul moyen de corriger le bug c’était de brancher la manette. Techniquement pour les portages PC, les possibilités de configuration et donc de conflits sont infinies.
LTB : Je vais essayer de corriger ma propre digression parce que je ne t’ai pas laissé nous raconter le moment que tu préférais dans le développement d’un jeu.
RT : Mon moment préféré il rejoint un moment que je déteste. C’est quand le jeu est sorti, et que je vais au studio le lendemain matin, et avec les collègues on se regarde et on se dit « ça y est, on a fini ». Tout le monde est content, avec un sourire aux lèvres. Ce moment, ça n’a pas de prix. Un jeu ça peut facilement être 2, 3, 4 ou même plus d’années de développement. Et de savoir qu’il est allé au bout, qu’il existe, que les gens peuvent y jouer et que plus rien ne peut empêcher ça, c’est incroyable.
Un autre moment que j’adore c’est le tout début, quand on se retrouve et que les gens partagent toutes les idées qu’ils ont, tout ce qu’ils voudraient pouvoir implémenter dans le jeu. Et tu réalises que les gens ont encore plein d’idées, de choses à raconter, que même s’ils sont là depuis des années, ils ont encore beaucoup à offrir.
Pour en revenir à la sortie d’un jeu, c’est aussi ce qui en précède un autre moment que je n’aime pas. Quand le jeu ne t’appartient plus. C’est paradoxal parce que tu vois les gens s’amuser, encore plus avec le stream et twitch aujourd’hui. Tu les vois s’amuser, rager, rire, et c’est génial, mais ça y est, le jeu ne t’appartient plus. Ce qui veut aussi dire qu’il est ouvert à la critique et parfois, c’est compliqué, surtout avec les réseaux sociaux, et le fait qu’on va plus facilement avoir tendance à parler de ce qu’on n’aime pas et générer de l’engagement dessus. Parfois c’est justifié, mais ce n’est pas le propos. Toi, tu te dis juste « Ok, je vous entends, mais vous n’étiez pas là, vous ne réalisez pas que c’est déjà un miracle que le jeu existe ». C’est normal de critiquer quand quelque chose ne va pas, mais pour les équipes, qui sortent de plusieurs années de travail, ça peut vraiment te ruiner le moral.
LTB : Avec l’expérience que tu as, plus de 15 ans les deux pieds dans le développement de jeux vidéo, est-ce qu’il y a des évolutions dont tu as été témoin, des changements que tu as observé dans le milieu ?
RT : Globalement, au fil des années, l’industrie a gagné en maturité. C’est fini l’époque où on installait des matelas dans les bureaux pour que les gens bossent sur place, où les développeurs étaient une bande de fêtards extraverties (entre eux). Avec la fin de ce type de comportement, tu es plus serein si ce n’est pas ton truc, si tu es plutôt timide. D’une manière générale, tout est plus professionnel.
Un autre point, c’est aussi l’augmentation du nombre de femmes dans les équipes. On est encore loin d’être sur un 50/50, il y a encore beaucoup de travail à faire de ce côté, mais ça vient, doucement mais sûrement. Ce qui est un bon indicateur c’est que dans les entretiens d’embauche que je fais, il y a beaucoup plus de femmes qui postulent par rapport à avant.
D’une manière générale, il y a une diversité beaucoup plus importante dans les studios. Beaucoup de personnes qui étaient (et sont encore) discriminées à l’embauche, intègrent le milieu et viennent sortir le jeu vidéo de cet aspect de réunion en non-mixité entre mecs blancs. Il y a encore pas mal de travail à faire mais on voit le changement s’opérer progressivement. Et ça c’est vraiment bénéfique pour l’industrie vidéoludique dans sa globalité. Je pense que ça s’inscrit aussi dans un rajeunissement des équipes, qui sont foncièrement plus progressistes que les anciennes générations.
Un autre point positif très récent, c’est l’émergence des syndicats dans le milieu du jeu vidéo. Et ce qui est fou c’est qu’il y a encore des gens qui hésitent à se positionner ou adhérer quand ils en ont l’opportunité. Par peur de représailles ou d’être vu comme des éléments potentiellement perturbateurs. Mais si tu bosses pour un studio et que tu es stigmatisé ou critiqué pour avoir rejoint un syndicat, c’est un gros red flag qui doit te faire comprendre que tu n’es pas au bon endroit. Ce qui fait avancer le jeu vidéo dans le bon sens, ce qui amène des changements positifs qui ont été opéré dans l’industrie c’est parce que des gens ont gueulés. Au final, le seul levier que tu as face à un groupe de décisionnaires quand les choses ne tournent pas rond c’est la confrontation. Si tu y vas seul, tu risques de perdre. Si tu y vas en groupe, et c’est là que les syndicats interviennent, tu peux faire entendre ta voix plus facilement pour mettre en lumière ce qui ne va pas. C’est une belle évolution, qui débute, mais dont le milieu sortira grandi.
LTB : Tu as évoqué des entretiens d’embauche que tu as dirigé en tant qu’employeur. Et à ce sujet, tu avais fait une session Twitch de plusieurs heures où tu donnais des conseils pour les personnes qui souhaiteraient se lancer dans l’industrie. Peux-tu nous partager quelques éléments essentiels de cette session ?
RT : Lors de cette intervention j’ai abordé beaucoup de détails techniques, sur les questions qu’on va poser en entretien en terme de programmation. Globalement, ça n’a jamais été aussi facile de développer ses propres jeux. Unity est accessible, Unreal aussi, RPG Maker … Ce n’est pas les soft pour faire les jeux qui manquent. Je n’en conseille pas un en particulier. Mais faire des jeux c’est compliqué et c’est important de savoir ce qu’on ne sait pas faire pour pouvoir apprendre de manière efficace et arriver en entretien avec le bon corpus de connaissance. Ce que ça veut dire c’est que pour faire pencher la balance à votre avantage, il faut faire des jeux, de votre côté.
Il faut savoir une chose, on ne regarde jamais, absolument jamais, vos diplômes. On s’en fout totalement. Que vous veniez de l’école d’informatique la plus chère du monde où que votre seul diplôme soit un CAP pâtisserie, pour nous c’est du pareil au même parce que ce qui nous intéresse c’est ce que vous savez faire. Le pendant de ça, c’est qu’il ne faut pas mettre des sommes folles dans des écoles, soit-disant prestigieuses, de jeu vidéo. Achetez vous un PC qui tourne bien, prenez les bons logiciels et créez des jeux, tentez des trucs. Profitez de l’accès extrêmement simplifié aux outils de création pour en maîtriser le maximum, parce que c’est ça qu’on attend. Si vous avez un très joli diplôme d’une école privée horriblement cher mais que vous ne maitrisez pas les outils qu’on va vous demander d’utiliser, vous ne serez pas pris. Le seul intérêt de ces écoles c’est le cadre de travail et le fait que vous allez être, normalement, entouré de personnes qui ont la même passion que vous. Mais si ce n’est pas nécessaire pour vous, pour vous imposer une rigueur de travail et vous plonger dedans, alors l’apport est limité.
Pour ma part j’ai fait une école publique d’ingénieur, et cette synergie, cette stimulation je l’ai trouvé dans les clubs d’informatique et de robotique de mon école. En tout cas, retenez qu’être diplômé de l’école privée la plus chère ce n’est absolument pas ce qui fera de vous un bon candidat.
Je suis agacé par ces écoles qui prétendent qu’elles vont faire de vous « un développeur de jeu vidéo » et dont les diplômés arrivent devant moi en entretien et se plante, alors qu’après je reçois quelqu’un qui n’a pas fait ces écoles hors de prix mais qui maîtrisent les outils sur lesquels le poste pourrait l’amener à travailler, qui a déjà créé des jeux de son côté, un logiciel de rendu, qui a eu des idées d’optimisation super malines etc. Mon choix est vite fait.
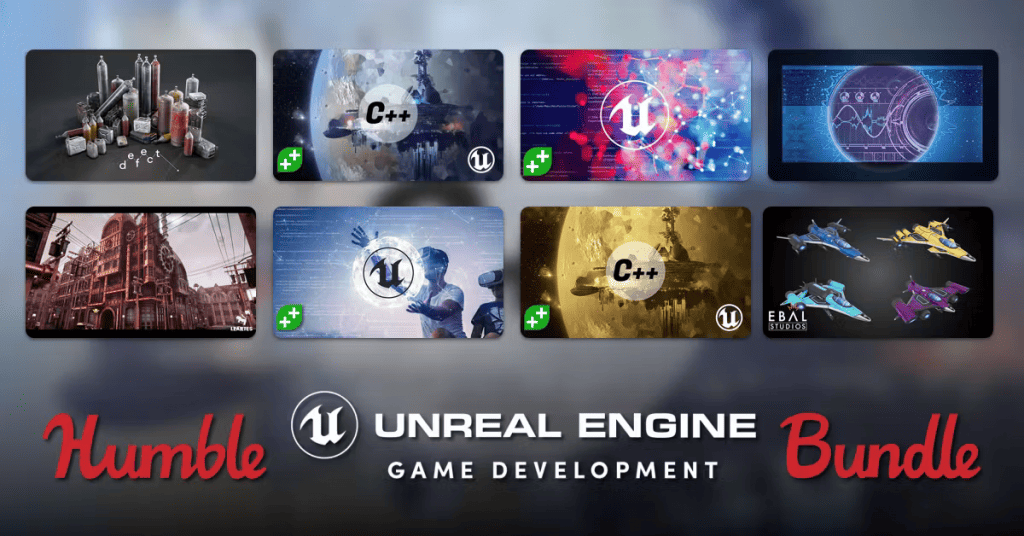
LTB : En dehors du boulot, tu expliquais que tu faisais du développement de ton côté. Et c’est quelque chose que tu fais notamment en direct sur Twitch. Est-ce que tu peux nous parler de ta vie de streameur à côté du boulot ?
RT : Alors, attention, on va partir en origin story. *rires*. Quand j’étais ado, je passais beaucoup de temps, la nuit, à programmer et à dessiner. Mon compagnon nocturne c’était la radio (Fun Radio…). Et j’ai développé un amour pour ce média. Une fois au lycée, j’ai voulu faire de l’animation radio parce que j’y étais attaché. Du coup, quand Twitch est devenu populaire, je me suis dit que ce serait cool de replonger dans cette forme d’animation, mais avec une communication qui avait évolué, beaucoup plus interactive. Aujourd’hui c’est un peu plus compliqué avec le décalage horaire depuis Edmonton. Mais j’essaye de continuer. Il y a des gens qui viennent sur mon stream, et ils font des choses à côté, un peu comme moi à l’époque où j’écoutais la radio, et j’aime l’idée de perpétuer ce schéma.
En plus de ça, Twitch avec son interactivité est un bon médium d’apprentissage. Par exemple, je code des jeux en indépendant depuis quelques mois, en live sur Twitch et au fil des échanges on partage des conseils, des astuces, comme on aurait pu le faire via des forums il y a quelques années mais d’une manière beaucoup plus directe et spontanée. Bien sûr, je fais aussi des streams de jeu vidéo, beaucoup plus classique, et parfois même des speedrun comme sur Resident Evil 7. J’aime beaucoup le speedrun. Le plaisir de casser un jeu c’est exquis.
LTB : Il y a quelques mois tu développais un jeu d’horreur en direct sur Twitch, et actuellement tu es sur un autre projet, il me semble.
RT : Oui, là je travaille sur un émulateur Megadrive pour la Playdate. C’est à la fois un challenge technique et ça permet d’apprendre des trucs à certains spectateurs curieux. Mais sur le jeu précédent, qui n’est pas terminé, on a travaillé sur le moteur graphique et pleins d’aspect. Avec le côté interactif du direct et la participation du chat de discussion c’est vraiment une excellente expérience.
LTB : Pour clôturer cet interview, j’aimerai te poser deux questions. Est-ce qu’il y a des jeux sur lesquels tu aurais rêvé de travailler ?
RT : Ohlala, il y en a tellement. Historiquement, j’aurais adoré commencer plus tôt, sur des jeux Megadrive, ou Super Nintendo. Plus récemment, je dirai le premier Resident Evil, Final Fantasy VIII/IX ou Shadow of the Colossus. Ce sont des jeux qui sont des prouesses techniques, et j’aurai aimé être là pour voir ça s’accomplir. Après, forcément il y a des jeux du cœur, comme Dark Souls ou Metal Gear Solid. Coté indépendant, le premier jeu qui me vient à l’esprit c’est Outer Wilds.

LTB : Pour finir, si tu devais conseiller un jeu et une bande son aux lecteurs et lectrices qui ont fait l’effort d’aller au bout de l’interview ? (Ou juste scroller de la page jusqu’en bas sans rien lire. On vous voit !)
RT : Outer Wilds. C’est un projet où les équipes avaient une idée atypique, et ils ont réussi à aller au bout. C’est du génie du début à la fin. Et niveau musical, j’écoute l’OST de Wild Hearts, je conseillerai aussi l’OST du DLC de Bloodborne, The Old Hunters, et surtout le morceau Ludwig The Holy Blade et si on sort du jeu vidéo je vous conseille de découvrir (ou réécouter) le groupe de rock progressif Haken.
LTB : Merci infiniment pour le temps que tu m’as consacré et bon courage pour la journée de travail à venir, vu l’heure qu’il est à Edmonton
RT : Merci à toi.
Propos recueillis le 30 mars 2023 lors d’un entretien sur Discord par Valentin Chauvin