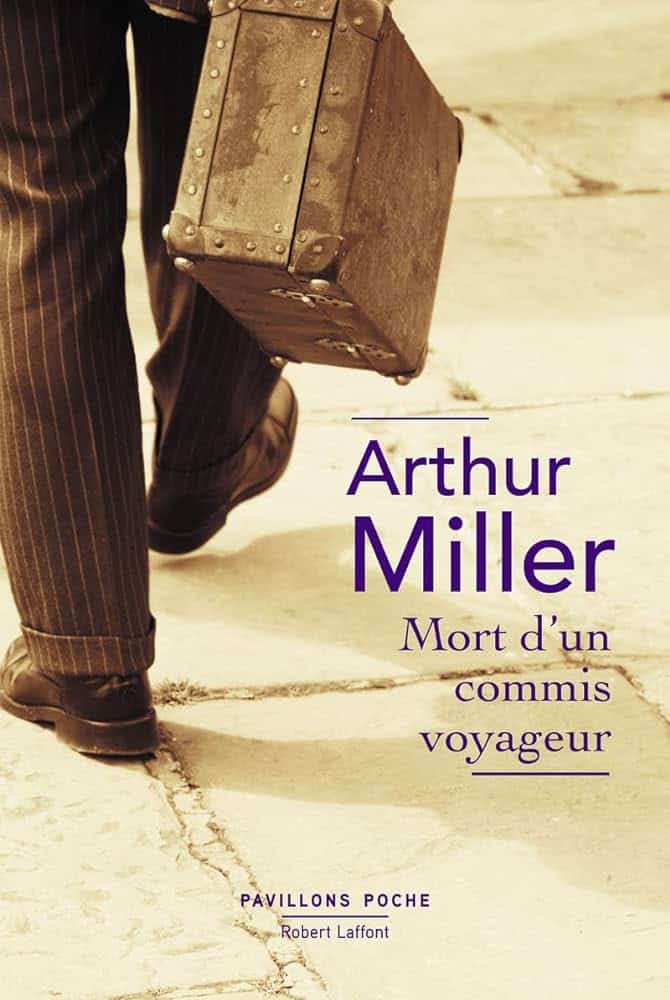“Ne vous servez pas de ce terme élevé d’idéal quand nous avons pour cela, dans le langage usuel, l’excellente expression de mensonge“ disait en 1906 Henrik Ibsen. Or, c’est précisément de cette confusion dont il retourne dans La Mort du Commis Voyageur, pièce d’Arthur Miller parue en 1949.
Nous y rencontrons la famille Loman, qui ne semble tenir debout que grâce à une accumulation prodigieuse de mensonges et d’exagérations. William, le père, emprunte de l’argent à son voisin toutes les semaines pour ne pas avouer à sa femme Linda qu’il ne gagne plus correctement sa vie. Pour les satisfaire, Harold, leur plus jeune fils, prétend qu’il s’apprête à se marier alors même qu’il rencontre une nouvelle conquête tous les soirs. La mascarade est d’autant plus grotesque que les personnages voient clair à travers le jeu des uns et des autres. Lorsque Bill, l’aîné, revient à la maison après plusieurs mois passés dans l’Ouest, il accepte de jouer la comédie pour ses parents jusqu’à ce que cette hypocrisie finisse par avoir raison de lui : mais qui voudra bien le suivre dans sa révolte pour la vérité ?
Arthur Miller délivre en une centaine de pages un portrait fidèle d’une Amérique qui se remet péniblement de la grande dépression et des deux guerres mondiales. Et pourtant, au coeur de cette nation déchue, les personnages sont tous, d’une manière ou d’une autre, habités par une version du rêve Américain. William rêve de la fortune qu’il aurait pu se forger en Alaska avec son frère, d’être un homme riche qui n’est parti de rien, Linda voudrait vivre à New York, l’épitome de la liberté, et Biff ne songe qu’à vivre dans un ranch à la campagne. Toutefois, ces aspirations se révèlent chaque jour plus futiles comme la réalité du consumérisme les rattrape : William s’offusque de constater l’obsolescence de son quotidien, et s’efforce tant bien que mal de laisser à ses enfants un héritage, mais son entreprise se révèle stérile. Il s’évertue de planter des graines dans son jardin où rien ne pousse jamais : les plaines prospères du nouveau continent semblent bien loin. Dans un tel contexte, tout semble désespéré et il n’est pas surprenant de constater que le drame final est déjà annoncé par le titre de la tragédie.
Par ailleurs, cette désillusion ambiante se traduit par la folie qui s’empare du personnage principal. Obsédé par la vie qu’il s’est inventée, William s’absente de plus en plus souvent pour éviter la médiocrité de son existence. Les regrets de son passé viennent le hanter, au point que l’intrigue est constamment entrecoupée de souvenirs et de fantômes avec lesquels il livre des conversations insensées, virant presque au théâtre de l’absurde par moments. Terriblement frustré, il fait preuve d’une grande agressivité envers ses enfants, dont il ne parvient pas à accepter les échecs. Cependant, il s’agit pour la famille Loman de sauver les apparences, quitte à feindre un sourire. Ce n’est donc pas par hasard qu’Harold a été surnommé Happy depuis son plus jeune âge; tout comme ce nom, l’entrain des personnages sonne faux.

Cette hypocrisie devient si prégnante qu’elle altère l’ensemble des relations familiales et qu’il devient presque impossible de s’en extraire. La plupart des personnages se complaisent dans cette fiction rassurante qu’ils ont construits pour eux-mêmes, et s’accrochent avec désespoir à des phrases toutes faites dont ils savent, au fond, qu’elles ne sont que mensonges. Willy, en particulier, semble avoir du mal à s’accommoder d’un monde qui avance plus vite que lui et s’exclame même à un moment : “Je refuse le changement !”. Bill, que tout ce cirque épouvante, tente tant bien que mal de ramener ses proches à la raison : “Restons en aux faits” répète-t-il par-dessus les voix qui le couvrent. Ces deux perspectives sont particulièrement sensibles dans la relation conflictuelle qui unit Bill à son frère.
La pièce s’apparente à une montée en tension permanente jusqu’au dérapage de Bill, qui, poussé à bout, en vient à détruire le tableau de famille épanouie auquel ses parents tenaient tant. “Cessez de vous faire passer pour ce que vous n’êtes pas !” semble-t-il crier aux spectateurs, les accusant presque personnellement d’avoir pris part à une comédie des apparences qui dépasserait le seuil de la scène. On peut déceler ici une possible dénonciation de l’auteur, à un moment où la famille rentre dans les valeurs promues par l’Amérique de l’après-guerre, et où beaucoup de femmes s’efforcent de faire bonne figure dans des existences frustrantes qui étaient présentées par les médias et le gouvernement comme idéales. Alors que les États Unis constituent un modèle sur la scène internationale, Miller semble en révéler les coulisses : une société de faux-semblants où le rapport à la nature et le sens de la vie se perdent. En ce sens, l’œuvre se rapproche d’Un Tramway nommé Désir, une pièce de Tennessee Williams publiée deux ans plus tôt. Dans ce scénario, c’est Blanche, l’héroïne, qui refusant d’admettre que les temps prospères de la noblesse sont passés, éprouve des difficultés à faire face à la réalité des relations sociales de son temps.
Suzanne La Rocca